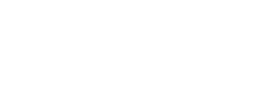16 septembre 2020 - Brésil : de la crise sanitaire à la dépression économique ?
C’est le deuxième pays du monde le plus touché et le plus endeuillé par l’épidémie de Covid-19. Six mois après avoir recensé son premier cas, on y recensait officiellement près de 4 millions de personnes contaminées et plus de 122 000 victimes létales. Le bilan économique et social de la pandémie sera aussi épouvantable. Depuis avril, le Brésil est en récession. Les prévisions de contraction du PIB varient selon les instituts de conjoncture de -4,5 % à -10 %. De nombreux facteurs ont désorganisé en profondeur l’activité : impéritie du gouvernement fédéral face à la crise sanitaire, mesures de confinement limitées et intermittentes, propagation rapide du virus, détérioration de l’environnement international. Tous les moteurs de la croissance sont touchés. La consommation intérieure a reculé. L’investissement productif (déjà très insuffisant) a plongé. L’excédent commercial devrait s’affaiblir en raison du tassement des exportations et malgré une forte baisse des importations. Les faillites d’entreprises croissent. Près de 9 millions de postes de travail ont été perdus (une chute de 9,6 %) entre janvier et juin 2020.
L’ampleur du choc économique et social aura cependant été limitée par les mesures anti-crises engagées dès mars dernier par le pouvoir fédéral. Après avoir décrété l’état de calamité publique (qui autorise l’exécutif à dépasser la limite du budget annuel), le Congrès a voté des crédits supplémentaires destinés à compenser les pertes de revenu des travailleurs, à préserver l’emploi, à soutenir les entreprises, à épauler les États fédérés et les communes et à augmenter les dépenses de santé. Au total, sur l’année, cet effort budgétaire devrait représenter 8,7 % du PIB, soit le taux le plus élevé sur tout le continent sud-américain.
L’épidémie est loin d’être terminée. Selon les projections, à la fin de 2020, le virus aura contaminé 7 millions de Brésiliens et fait 200 000 morts. À partir de septembre, la dynamique de la contamination devrait cependant être freinée et la mortalité diminuer. Si ce scénario est confirmé, la reprise déjà engagée se consolidera sur 2021. En décembre prochain, l’état de calamité publique sera levé. L’administration fédérale ne pourra plus engager de dépenses exceptionnelles. Elle devra gérer et exécuter les seuls crédits budgétaires votés dans le cadre de la loi de finances annuelle et respecter à nouveau la règle de plafonnement des dépenses instaurée en 2016[1]. C’est ce que prévoit la Constitution. Pourtant, dès juin dernier, au sein de l’exécutif comme dans les rangs des élus du Congrès, un mouvement politique puissant est apparu qui s’oppose à ce retour à la normale de la politique budgétaire et préconise une expansion continue des dépenses.
Cette résistance procède à la fois d’une étrange amnésie et de calculs électoralistes. Les politiques d’accroissement de la dépense publique ont effectivement un effet contracyclique de court terme dans la conjoncture sombre que connaît le pays. Elles améliorent temporairement l’emploi et les revenus. L’expérience récente montre pourtant que cette option ne permet pas de relever de façon durable la capacité de production du pays et le rythme de progression de la productivité. Elle n’entraîne pas d’élévation soutenable du revenu national et de celui des plus pauvres. Le gouvernement Bolsonaro envisage aujourd’hui une relance par un accroissement sensible des dépenses fédérales. Il s’agirait de dynamiser les investissements publics (notamment dans le secteur des infrastructures), de créer ainsi des milliers de postes de travail, de compenser l’hémorragie d’emplois que va connaître le secteur privé. Un Président d’extrême droite en vient ainsi à renouer avec le volontarisme dépensier des gouvernements Lula et Rousseff (entre 2010 et 2016) qui pilotaient un « Programme d’Accélération de la Croissance ». La prodigalité budgétaire pratiquée alors n’a pas relancé l’investissement et l’activité. Elle a précipité le Brésil dans la grande récession des années 2014-2016.
Depuis le début de la crise du Covid-19, Jair Bolsonaro a cherché à élargir sa base d’appui parlementaire. Il a construit une alliance avec tous les partis qui constituent un marais au sein du Congrès. Comme le Président, les leaders de ces formations opportunistes croient que la relance de l’activité par une flexibilisation des disciplines budgétaires stimulera l’activité, l’emploi et garantira leur réélection en 2022. Le chef de l’État a compris qu’une des mesures phares du plan d’urgence adopté en mars pouvait servir ses intérêts. Il s’agit d’une allocation mensuelle versée aujourd’hui à plus de 66 millions de Brésiliens en situation de précarité et de pauvreté. Fixée à 600 réais par mois (environ 90 euros), ce transfert exceptionnel a d’abord été versé entre avril et juin. Il a été maintenu ensuite sur juillet et août. Avec un montant divisé par deux, il sera prolongé finalement jusqu’à la fin de l’année. Ce « RSA » temporaire a effectivement amélioré le sort des ménages les plus pauvres. Il a aussi permis à Jair Bolsonaro de gagner la sympathie et l’appui de secteurs de la population qui votaient jusqu’alors pour le Parti des Travailleurs de Lula. Pour le budget fédéral, l’addition n’est cependant pas négligeable : sur l’année, l’allocation temporaire représentera une dépense équivalente à 5,1 % du PIB.
Le Président n’a que faire de ces calculs d’apothicaire. La suppression définitive du « RSA » d’urgence ou une réduction significative du montant une fois la crise sanitaire dépassée susciteraient certainement la déception et la rancœur des bénéficiaires. Il s’agit donc désormais pérenniser le dispositif en le transformant en allocation permanente. La prodigalité présidentielle est aussi liée aux pressions de sa base qui pousse à la dépense et à l’abandon des règles constitutionnelles. Les parlementaires du « marais » encouragent le gouvernement à mettre en œuvre un plan de relance de l’économie basé sur de grands travaux et la reprise de projets d’investissements en infrastructures. Qu’importe si ces opérations aboutissent souvent à faire pousser des éléphants blancs. Il suffit d’annoncer des réalisations d’envergure et prestigieuses pour susciter la sympathie et l’adhésion d’importants secteurs de l’électorat. En outre, la mise en œuvre de chantiers coûteux pour les finances publiques est souvent bénéfique pour les leaders politiques locaux et leurs partis…
Des finances publiques fragilisées.
Ces dérives sont dangereuses. En dépit des efforts d’ajustement menés depuis 2016, la situation financière de l’État reste problématique. Avant la crise sanitaire, la dette publique du Brésil rapportée à son PIB était déjà très élevée pour un pays émergent. L’effort budgétaire massif engagé depuis mars était nécessaire. Il doit rester limité dans le temps. Alors que les recettes fiscales plongent, cet effort va creuser considérablement le déficit public (voir tableau), financé essentiellement par un nouvel endettement. De 75,8 % du PIB à la fin 2019, la dette publique fédérale est passée à 85,5 % à la fin juin. Elle atteindra plus de 96 % du PIB en décembre prochain.
Pour envisager une relance sur des bases solides, le Brésil devra montrer dans les prochains mois qu’il est capable de revenir à une gestion rigoureuse de ses finances publiques. Si les règles de contrôle de la progression des dépenses sont délaissées (avec l’abandon ou la flexibilisation du fameux plafonnement), un scénario plus sombre s’imposera dès la fin de l’année. Incapable de rétablir un climat de confiance, de rassurer les acteurs économiques et les marchés financiers, le gouvernement fera passer le pays d’une récession limitée à une dépression durable. Les projections les plus pessimistes envisagent une contraction du PIB en 2020 supérieure à 10 %, une nouvelle contraction ou la stagnation en 2021 et une reprise qui ne se concrétiserait qu’en 2022. Depuis juin dernier, lorsque Jair Bolsonaro a commencé à envisager un effort de relance qui s’affranchirait des disciplines budgétaires, les marchés financiers considèrent que ce scénario noir n’est plus une hypothèse improbable.
Investisseurs et agences de notation n’en sont pas encore à envisager une crise de la dette souveraine. Néanmoins, durant les derniers mois, les signes de fièvre sont devenus évidents. Les deux agences de notation Standard & Poor’s et Fitch ont abaissé la perspective de la note souveraine du Brésil, de « positive » à « stable » pour la première (en avril dernier), de « stable » à « négative » pour la seconde (début mai). Les investisseurs sont inquiets et le manifestent. Entre janvier et juillet 2020, les sorties nettes de capitaux liées à la liquidation par des étrangers de placements en actions, en fonds d’investissements et titres de la dette publique ont atteint 30,6 milliards de dollars. Par rapport à 2019, le mouvement s’est inversé (les entrées nettes étaient alors de 14,1 milliards de dollars). Pour les douze mois terminant en juillet 2020, l’hémorragie est de 52,3 milliards d’USD. Après avoir longtemps résisté au mouvement, la bourse de São Paulo a fini par le suivre. Les cotations se sont affaissées en août.
Un signe traduit plus que les autres la nervosité et l’anxiété des marchés : la forte volatilité du dollar et l’affaiblissement de la monnaie brésilienne. Depuis le début de l’année, celle-ci a enregistré la pire performance par rapport au billet vert au sein des pays émergents (-28,3 %, contre -19 % pour la livre turque). Après avoir connu un gros accès de fièvre au mois de mai lors du premier vent de panique lié à l’impact du coronavirus, le réal avait quelque peu rétabli l’équilibre le mois suivant (le dollar repassant alors sous la barre des 5 réais). Il a depuis replongé (le billet vert s’établissant à 5,46 réais en moyenne sur le mois d’août), malgré de nombreuses interventions de la banque centrale. La dépréciation marquée de la monnaie brésilienne sur l’année accompagne un mouvement d’en-semble (sortie des investisseurs des pays émergents). Elle est aussi liée à la perception par les marchés d’un risque accru sur la dette publique brésilienne. Le ministre de l’Économie (de moins en moins écouté par Jair Bolsonaro) a beau répéter que le gouvernement reste attaché à la discipline budgétaire. Les investisseurs savent que le Président et plusieurs ministres militaires sont désormais partisans d’une expansion des dépenses.
Ces investisseurs sont des comptables réalistes. Les nombreuses privatisations annoncées depuis 2019 devaient fournir des recettes importantes. Elles n’ont pas eu lieu. Avec une pression fiscale déjà très élevée, le pays peut difficilement envisager de nouveaux impôts. Il n’a pas mis en œuvre les mesures qui lui auraient permis de mieux maîtriser la progression des dépenses budgétaires. Régulièrement évoquée depuis l’investiture de Jair Bolsonaro, une réforme administrative devait permettre de stabiliser les coûts élevés en personnels, gonflés par les nombreux avantages dont jouit la haute fonction publique. Elle a été bloquée par le Président sensible aux pressions de lobbys puissants et organisés. La réforme des retraites de 2019 a été insuffisante. Nos comptables calculent. Ils savent que la somme des dépenses obligatoires (rémunérations, pensions, autres prestations sociales) et des crédits nécessaires pour assurer le fonctionnement de la machine administrative fédérale va excéder en 2021 le fameux plafond budgétaire. Celui-ci sera largement dépassé si le gouvernement lance ses projets de « RSA » permanent et son programme d’investissements publics. Le déficit public augmentera. La dette gonflera et son financement deviendra problématique.
Un risque financier intérieur.
Cette dette fédérale est principalement une dette interne. C’est aussi avant tout (pour 94,56 % du stock en fin juin 2020) une dette mobilière. Qui sont les détenteurs des titres émis par le trésor brésilien ? En juin dernier, les investisseurs non-résidents dans le pays ne représentaient que 9,1 % de l’encours. Les titres en circulation étaient alors détenus pour plus de 81 % par des fonds de pension (retraites complémentaires), par des institutions financières, par des compagnies d’assurances et des fonds d’investissement tous brésiliens. Directement et indirectement, une large part de l’épargne des entreprises et des ménages est placée en titres de la dette publique qui représentent souvent les supports offrant la meilleure rentabilité.
La charge annuelle de cette dette publique (amortissement + frais financiers) n’est jamais assumée intégralement en mobilisant des ressources fiscales. L’État fédéral rembourse les bons du Trésor et obligations venus à échéance en s’endettant à nouveau, en se refinançant. Entre 2015 et 2019, la part de la charge annuelle inscrite au budget a été en moyenne de 8,5 %. Le reste (91,5 %) a été financé par émission de nouveaux titres et la contractation de nouveaux emprunts. Considéré à juste titre comme un débiteur problématique, l’État ne définit pas le prix qu’il paie pour se financer et le temps pendant lequel il peut utiliser des ressources captées sur le marché. S’il bénéficie de la confiance des investisseurs, il parvient à émettre de la dette moyennant des conditions relativement favorables (maturités longues des titres, taux d’intérêt faibles). Lorsque ces investisseurs perdent confiance dans la qualité des titres de dette proposés, les taux d’intérêt s’envolent et l’État parvient de plus en plus difficilement à se financer à long terme (quelques années) sur les marchés[2]. La confiance varie en fonction de la politique budgétaire menée. La rigueur pratiquée depuis 2016 a permis de réduire le coût du refinancement de la dette (le taux implicite de la dette brute est passé de 13,1 % à 7,8 % entre 2016 et 2019). Elle a permis aussi d’allonger les maturités des titres émis. Le stress que connaissent les marchés depuis quelques mois génère des effets inverses.
Les investisseurs savent que l’année 2020 est une année particulière. En raison des maturités des diverses émissions réalisées avant la crise sanitaire, de la récession qui accompagne l’épidémie (entraînant une contraction des recettes fiscales) et de l’effort budgétaire exceptionnel engagé, le besoin de financement du secteur public brésilien va être très élevé. Pour rembourser les titres qui viennent à échéance, payer les intérêts dus et couvrir un déficit primaire considérable, le Trésor brésilien doit placer sur le marché des nouveaux titres représentant au total l’équivalent de 46 % du PIB[3]. En d’autres termes, les atermoiements du gouvernement à propos du maintien du plafonnement des dépenses, les polémiques publiques nourries sur le sujet surviennent au pire moment. Les marchés financiers brésiliens anticipent déjà une répétition du scénario de 2002, lorsque les investisseurs étaient devenus très réticents pour financer le Trésor et souscrire les titres émis parce qu’ils anticipaient un total relâchement de la discipline budgétaire avec la victoire annoncée de Lula à la présidentielle. À l’époque, le Trésor ne parvenait même pas à négocier des titres à échéance 2003, première année de la gauche au pouvoir. Pour éviter la banqueroute, il a fallu proposer des titres de maturité très courte assortis de taux de rémunérations très élevés. La bombe a été désamorcée lorsque le nouveau chef de l’État s’est engagé à maintenir une stricte discipline budgétaire et l’a effectivement mise en œuvre.
Aujourd’hui, le Trésor brésilien est confronté à deux évolutions qui annoncent un scénario comparable. Il doit d’abord proposer des niveaux de rentabilité plus élevés pour placer les titres de la dette publique sur le marché. Il doit aussi réduire la maturité des nouveaux titres émis. Les taux d’intérêt à long terme (qui servent de référence aux investisseurs lorsqu’ils envisagent de souscrire des titres de la dette fédérale) ont augmenté sur les derniers mois. Les investisseurs intègrent désormais dans leurs analyses de rentabilité le risque représenté par de possibles dérapages budgétaires. Les taux de long terme que doit accepter le Trésor pour émettre des emprunts à dix ans atteignent désormais 7 %[4]. Cet écart énorme avec les conditions proposées dans les nations avancées reflète la méfiance des créanciers qui craignent que les engagements contractés aujourd’hui ne soient pas honorés à échéance. Autre traduction de cette même inquiétude : la réduction de la maturité moyenne des titres de la dette publique. En 2016, celle-ci était de 4,5 ans. Elle est aujourd’hui inférieure à trois ans. Sur les derniers mois, les maturités proposées sur les nouvelles émissions étaient inférieures à douze mois.
Ces émissions de titres à maturité réduite permettent de diminuer les charges financières de la dette. Néanmoins, la structure d’amortissement est moins lissée. Le montant exigible à court terme augmente. Les risques auxquels s’expose le Trésor (difficulté de placer de nouveaux titres, relèvement brutal des taux d’intérêt) s’élèvent. Le raccourcissement accéléré sur les derniers mois de la maturité moyenne de la dette publique est en soi un signal d’alarme qui devrait conduire le gouvernement fédéral à afficher clairement un programme de réduction des déficits pour l’après-crise sanitaire. Un autre signal inquiétant est le recours de plus en plus fréquent par le Trésor à d’autres moyens de financement que l’émission de titres nouveaux sur le marché primaire. Ces derniers mois, la Banque Centrale a ainsi multiplié les opérations de pension livrée afin de financer le Trésor[5].
De la récession à la dépression.
Si le cap de la discipline budgétaire n’est pas retrouvé sur les prochains mois, le Brésil connaîtra probablement à nouveau des tensions inflationnistes (alimentées par la dépréciation du réal). La Banque centrale devra alors relever son taux directeur. Ce raidissement de la politique monétaire rendra l’accès au crédit plus difficile et pèsera sur une reprise de l’activité déjà fragile. Il ne suffira probablement pas pour empêcher la fuite devant la monnaie nationale. Les épargnants qui le peuvent chercheront à acquérir des dollars ou d’autres devises fortes. Faut-il alors envisager un dénouement à l’Argentine ?
L’essentiel du stock de la dette publique étant libellé en réais et détenu par des institutions financières locales, un scénario de défaut (le débiteur annonçant qu’il n’est plus à même de respecter ses engagements) ou une restructuration de la dette imposée sont difficilement envisageables. Ces ruptures unilatérales de contrats généreraient une crise de l’ensemble du système financier national compte tenu du poids pris par les titres de la dette fédérale dans les bilans des investisseurs institutionnels. Elles mettraient en péril les systèmes de retraites complémentaires, provoqueraient un effondrement de l’investissement productif, un cataclysme économique et une spoliation violente des épargnants.
La défaillance sera plus discrète et sournoise. Aux abois, l’État encouragera la Banque centrale à créer de la monnaie sans contrepartie. Le retour d’une inflation élevée dévalorisera les créances sur le Trésor qui représenteront une charge de moins en moins lourde pour le débiteur et des actifs dévalorisés pour les créanciers. Ici encore, les épargnants seront lésés, mais de manière plus insidieuse. Il n’y aura pas de cataclysme économique spectaculaire mis une dépression sans fin prévisible. Le pays combinera pour longtemps l’instabilité des prix et une croissance négative ou médiocre.
Le pari électoraliste de Jair Bolsonaro et de ses alliés est donc probablement un pari absurde. Pour renforcer leurs chances électorales en 2022, ils semblent prêts à abandonner l’effort de discipline budgétaire engagé depuis 2016. Si ce virage populiste esquissé récemment est confirmé, les classes moyennes (disposant d’épargne) et les pauvres (qui perdront leurs emplois et recevront un RSA dévalorisé) paieront rapidement une addition très amère. Il est difficile d’imaginer que ces secteurs de la société persistent alors à soutenir des candidats du camp Bolsonaro.
[1] Cette disposition constitutionnelle (connue sous le vocable de « plafond des dépenses ») introduite en 2016 limite la progression des dépenses fédérales d’un exercice budgétaire à l’autre au taux d’inflation. Elle est en vigueur pour 20 ans. Elle a permis de réduire le déficit des finances fédérales et le rythme de progression de la dette publique sur les années récentes. Le mécanisme est assez souple. Il permet de faire face à des situations exceptionnelles, non prévisibles. Ainsi, les dépenses extrabudgétaires qui ont été engagées pour combattre le Covid-19 et ses conséquences sont financées par des crédits extraordinaires, exclus du calcul du plafond de dépenses.[2] In fine, l’État peut se trouver dans une situation où il ne peut assurer ni les remboursements ni le paiement des intérêts sur les dettes contractées. Le refinancement devient impossible. L’État se retrouve en défaut de paiement. Au Brésil, cette situation s’est produite à plusieurs reprises au cours des dernières décennies.[3] Jamais le besoin de refinancement de l’État fédéral n’a été aussi important ces dernières années. À titre de comparaison, jusqu’à la récession qui a commencé en 2014-15, il représentait l’équivalent de 20 à 25 % du PIB.[4] Ces taux de long terme pour des emprunts à plus de dix ans varient de 5 à 7 % pour l’ensemble de pays émergents.[5] Vente par la Banque Centrale des titres de la dette publique pour emprunter des liquidités avec l’engagement de racheter ces titres sur un délai rapproché, en général de 24 heures.